L'Art de perdre
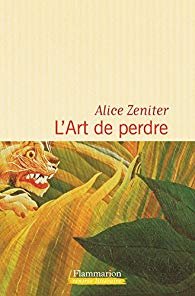
Cette Algérie-là, on ne l'avait encore jamais racontée. Dans L'Art de perdre, récit bien plus complexe et foisonnant que Sombre dimanche qui lui avait valu le prix du Livre Inter en 2013, Alice Zeniter évoque une mémoire familiale rongée de névroses et de non-dits. Comme un passé qui ne passe pas. Surtout lorsqu'on n'a pas choisi le bon camp, là-bas, sur l'autre rive de la Méditerranée, au moment où le FLN se dressait contre la France coloniale.
Mais au fait, à quel moment choisit-on son camp et est-ce vraiment l'affaire d'un "moment", s'interroge l'auteure, elle-même petite-fille de Harki ou du moins désigné comme tel ? Harki. Le mot infâme, l'assignation qui déclenche illico un froncement de sourcil ou un regard apitoyé... Ali, le montagnard kabyle enrichi grâce à la culture des olives et dont l'odyssée constitue la première partie du récit, ne s'est pourtant jamais engagé comme supplétif. "La France, vous savez, pas plus que ça...", pourrait-il répliquer à ceux qui, après coup, sont tellement brillants dans l'art de simplifier les trajectoires. Il a seulement mal calculé son coup, estimant que ces fellaghas (d'emblée, son langage l'a trahi. Il a pensé fellag au lieu de moudjahid) du FLN étaient bien trop immatures à son goût. Alors pour protéger son village, il a donné des renseignements aux Roumis.
Et puis il y avait le souvenir des répressions passées, Sétif, cet "ogre terrifiant"... Sauf que dans les barbelés et les cauchemars nocturnes de Rivesaltes, le camp provençal où Ali et les siens sont parqués comme des parias après l'Indépendance, chacun, désormais, "porte son ogre individuel, un ogre de poche qui a lui aussi pris le bateau et qui sort la nuit". Ainsi débute la seconde partie du récit, celle qui voit grandir Hamid, le fils d'Ali, peu à peu amené à demander des comptes à son père sur ce que fut son comportement pendant la Guerre d'Algérie. Mais le vieux est taiseux, et le fils le deviendra encore d'avantage.
Un fossé linguistique ("le français vient truffer la surface des paroles"), culturel et politique -on est en pleine décennie des Indépendances- sépare les générations tandis qu'Ali, cassé par l'exil, n'est plus que l'ombre de lui-même. Du passé, pourtant, il est difficile de faire table rase. "Qu'est ce que ça raconte ?" demande la frangine d'Hamid à son jeune frère lecteur du Club des Cinq ? "Mick s'est fait enlever", résume le garçon. Et la petite de rétorquer: "C'est sûrement un coup du FLN".
C'est avec cette Algérie de bribes et de souvenirs interdits que doit composer Naïma, la fille d'Hamid et petite-fille d'Ali, lorsque sa galerie parisienne l'envoie en Kabylie pour rassembler l'œuvre d'un peintre local. Quête des origines ? Pur cliché, selon l'un de ses guides: "Qu'est-ce que tu croyais ? Qu'un pays, ça passe dans le sang ? Que tu avais la langue kabyle enfouie quelque part dans tes chromosomes et qu'elle se réveillerait quand tu toucherais le sol ?". Déracinement et affranchissement. En questionnant le mythe de l'algérité à rebours de bien des crispations identitaires, Alice Zeniter signe un récit résolument contemporain. Finesse d'écriture et puissance romanesque aidant, on tient bien là le joyau de cette rentrée littéraire.
L'Art de perdre, Alice Zeniter (Flammarion). Coup de projecteur avec l'auteur, ce lundi 4 septembre, sur TSFJAZZ, à 13h30.





