Panique générale
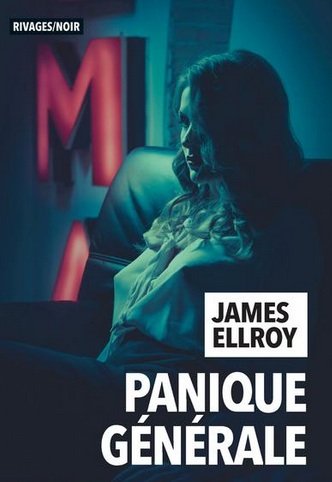
Sa plume persifle, grésille, carbonise... Bref, James Ellroy a de nouveau la niaque. Pas autant qu'à l'époque d'Underworld Usa et Perfidia, ses deux climax de la période 2009-2014, mais bien plus efficacement que dans l'indigeste La Tempête qui vient, prolongement rasoir et emberlificoté de sa fresque sur le Los Angeles des années de guerre. Le curseur est désormais fixé sur la décennie qui suit, ce qui permet à l'auteur du Dahlia noir de réactiver un bad guy au diapason de son univers: Freddy Otash, amateur de be-bop ("Charlie Parker a passé le saxo à gauche au mois de mars. Il reste son sourire béat ") et ancien flic devenu détective privé pour un tabloïd exposant la vie privée des célébrités.
Industrie éminemment lucrative lorsqu'on a comme champ d'action le Hollywood maccarthysé des années 50 si attaché à son statut d'usine à rêves. Ces rêves, Otash les éparpille façon puzzle, comme dirait l'autre. Ses frasques façon "chien pervers" (il se surnomme lui-même le "pervdog ") et sa brutalité sous amphets entre chantage, racket et écoutes sauvages ont pourtant un air de déjà vu. Surtout si on a lu Extorsion. Même personnage, même marigot hollywoodien, même ciel rose et mauve au-dessus de L.A. lorsque les essais nucléaires du Nevada étaient considérés comme une attraction touristique.
À ceci près que la chronologie s'étend. Extorsion restait buté sur l'an 53 avec une Liz Taylor baignant dans le péché et un James Dean en mauvais ange pasolinien. Ellroy suit l'ascension de ce dernier, et notamment le tournage mouvementé de La Fureur de vivre en 1955. Il n'est pas tendre, c'est le moins qu'on puisse dire, pour son réalisateur, "Nick" (Nicholas) Ray, parangon d'un cinéma de gauche qu'il exècre et auquel il prête des mœurs libertines, notamment à l'endroit de la toute jeune Natalie Wood. Il est aussi question dans le récit du célèbre condamné à mort Caryl Chelsman que James Dean aurait voulu incarner à l'écran, toujours sous la direction de "Nick" Ray, ce qui met en pétard Freddy Otash.
Ce dernier craque aussi, entre deux enquêtes, pour des femmes aussi vénales que vénéneuses. Il y en a trop. Otash se disperse, le lecteur également, au risque de diluer le concentré de nitroglycérine qui faisait la cohérence des grands thrillers d'autrefois. Reste l'envers et surtout l'envergure du décor, mais aussi ce venin du voyeurisme à travers lequel James Ellroy, avec son style parfois bien trash, résume une certaine Amérique ainsi que cette fameuse "culture des médias modernes qui déballent tout "...
Impossible dans ce grand "déballage" de ne pas croiser une vieille connaissance de l'auteur, à savoir un certain John Fitzgerald Kennedy. C'est le seul personnage qui ne transpire jamais, l'allure bienséante et le cœur froid comme il faut. Ellroy manifeste bien plus de tendresse pour le léopard de Liberace, vedette kitchissime des années 50. L'animal est aussi irrésistible qu'un autre félin du même genre repéré dans Perfidia en train de dévorer des nouilles sautées dans l'assiette de Count Basie.
Panique générale, James Ellroy, traduit par Sophie Aslanides (Éditions Rivages/Noir)





